- Accueil
- > Les publications
- > Collection La Licorne
- > 2000
- > La Ponctuation
- > Une ponctuation en devenir (Moyen Âge – Renaissanc ...
- > PONCTUATION ET NARRATION CHEZ RABELAIS ET SES CONTEMPORAINS
PONCTUATION ET NARRATION CHEZ RABELAIS ET SES CONTEMPORAINS
Partie I
Par Marie-Luce DEMONET
Publication en ligne le 08 avril 2014
Table des matières
Texte intégral
« Une punctuation bien gardée, & observée sert d'une exposition en tout œuvre1 ».
1L'histoire de la ponctuation au XVIe siècle en France est particulièrement complexe et doit être distinguée de celle de l'orthographe, celle-ci étant régie pendant tout le siècle par des pratiques qui ont mis en échec les réformes radicales des phonétistes alors que la standardisation de la ponctuation s'est mise en place sans coup d'éclat (Catach 1968). Les réformateurs ne s'y sont pas tous intéressés, puisqu'elle ne correspondait pas à une verbalisation ou à une relation biunivoque entre l'écrit et l'oral2. Nous disposons de quelques textes qui tentent de systématiser des pratiques ou d'imposer un système issu des langues classiques, mais aucun d'entre eux n'a entièrement dominé la composition des imprimeurs. Même si l'on retrouve un semblant de « querelle » à propos des virgules autour de Dolet (Huchon 1988 : 20), elle n'atteint pas l'aigreur des discussions qu'ont provoquées à la même époque les tentatives d'imposer une transcription phonétique. Les théories qui sous-tendent les usages ponctuants portent sur la mise en relief de la syntaxe et des parties du discours, éventuellement sur le rythme de la phrase, mais non sur la visibilité graphique d'un élément sonore. Dans cette période de formation d'un usage dominant, s'interroger sur les relations entre le récit et la pratique de la ponctuation conduit à isoler des genres qui ne sont pas encore reconnus par les arts poétiques (roman, nouvelle) et qui portent leurs règles implicites de fonctionnement. Étudier la distribution des signes de ponctuation dans la narration constitue aussi une tentative de délimitation des genres du récit par rapport au traité ou à l'essai.
LA PONCTUATION DU LATIN2En-dehors de l'ouvrage de Parkes (1992), nous ne disposons pas encore d'étude d'ensemble sur la ponctuation des manuscrits français des XVe et XVIe siècles, en français et en latin, qui permette une comparaison complète des usages introduits par l'imprimé. Comme l'a montré Nina Catach (1968, 1979, 1980), les graphies et la ponctuation sont surtout affaire d'imprimeurs, même si les auteurs ont tenté d'intervenir en faisant appliquer avec plus ou moins de succès leurs idées de réformes, de modernisation ou au contraire de retour à l'antique. Pour un Rabelais qui y réussit presque, un Ronsard échoue et doit revenir sur ses audaces. Les imprimés latins de cette époque étant plutôt hyperponctués dès le XIIIe siècle, on peut s'interroger sur l'évolution des textes en langue vulgaire qui semblent avoir été faiblement segmentés au XVe siècle. Les éditeurs de Chaucer partent de documents presque nus et les travaux de Céline Barbance sur les traductions de Boccace par Laurent de Premierfait (1992) confirment l'usage parcimonieux de ces signes dans le vernaculaire narratif vers 1400 ; en revanche, les évaluations de Christiane Marchello-Nizia sur les manuscrits et l'édition du Jouvence! l'amènent à constater l'extrême diversité des usages3.
3Les travaux de Parkes et de Gilbert Ouy (1979, 1987) permettent de comprendre comment les usages du latin ont servi de base à la ponctuation des langues vernaculaires, bien que N. Catach (1968 : 71) insiste davantage sur l'héritage grec transmis par Cassiodore et Donat. Contrairement aux nouveaux accents du français, pour la plupart empruntés au grec, les points sont issus de la tradition latine de la scriptio distincta par opposition à la scriptio continua des Grecs ; peul-être d'origine étrusque (Parkes 1992 : 10), l'écriture distincte était au temps de Quintilien surtout une aide pédagogique pour le lecteur, qui repérait ainsi les pauses en fonction de la structure rhétorique de la phrase4. Un bon orateur n'avait pas besoin de ponctuer mais, lorsque le latin est devenu langue seconde pour les régions parlant une autre langue de communication, la ponctuation du latin est apparue comme nécessaire et a donné naissance aux systèmes qui se mettent en place du Moyen Age au XVIe siècle, en concurrence avec les habitudes que les copistes se transmettaient. Ce processus ne constitue pas une filiation uniforme puisque, si l'on regarde les tout premiers traités de ponctuation humaniste (Ouy 1987 : 182), celui de Gasparino Barzizza et de Jean Heynlin (14715), on constate leur disparité. Le système de Heynlin à quatre signes (colon, comma, periodus et virgula), publié à Paris sur les presses de la Sorbonne, bien qu'il soit repris dans la Grammatografia de Lefèvre d'Etaples (1529), n'est pas celui qui a prévalu (la valeur des points hauts et bas sera inversée). L'hésitation sur la forme et le sens de ces ponctèmes est explicable par la diversité des traditions (latine, grecque classique et grecque byzantine) qui a pu se combiner avec les traditions locales vernaculaires et les apports italiens.
4Nicolas de Clamanges (au tournant du XIVe siècle) donnait comme critère premier celui de la compréhension de la phrase latine, par la nécessité de distinguer les membres de phrase et de suivre leur impetus (Ouy 1987 : 169). Un manuscrit autographe de Gerson témoigne du même idéal de logique et de simplicité, ce qui n'était pas toujours le cas : Jean de Montreuil, admirateur des humanistes et en même temps héritier de la chancellerie, pratique un système complexe à sept signes. Ouy rappelle qu'à cette époque on utilisait deux orthographes : une courante pour les brouillons, une autre d'apparat archaïsante (ibid.). Jacqueline Hamesse (1987 : 136-151) confirme de son côté que les notes de cours ont une ponctuation inexistante ou rudimentaire. Il est fort probable que ce double usage a subsisté encore au XVIe siècle : dans ses additions marginales à J'édition de 1588 des Essais (exemplaire de Bordeaux), Montaigne utilise non seulement des graphies simplifiées mais aussi une ponctuation des plus réduites. En revanche, ses interventions sur la partie imprimée du texte sont extrêmement précises pour la rectification de la ponctuation dans le sens d'un « langage coupé » étudié par André Tournon (1993, 1995, 1997, 1999). La redécouverte de Quintilien à la fin du XVe siècle a pu encourager cette aide à la lecture et à l'interprétation qu'est la ponctuation, mais le discours théorique sur la segmentation relève encore des trois sciences du langage : la rhétorique, la grammaire et la logique.
LA SEGMENTATION : TORY DOLET, MEIGRET, RAMUS5La ponctuation renaissante est avant tout affaire de segmentation de la phrase (Baddeley 1998 et Biedermann-Pasques 1998). Or les mentions de la ponctuation du français précèdent la première grammaire systématique de cette langue et en français par Louis Meigret en 15506. Il fallait donc segmenter avant même que les grammairiens aient explicitement transféré l'analyse logique de la phrase latine au français ou proposé une nouvelle forme de segmentation. Pendant ce temps, les imprimeurs ponctuaient à leur manière et en fonction des fontes disponibles dans leurs ateliers. La dissociation entre théorie et pratique est particulièrement frappante dans le cas du célèbre Champfleury de Geoffroy Tory, commencé en 1523 et publié seulement six ans plus tard. Bien que ses beaux dessins de lettres aient quelque peu fait oublier sa dimension théorique, cet ouvrage se présente comme un début de grammaire, prélude à ce traité général de la langue et de la poésie française que l'on attendait d'Etienne Dolet. La lettre, qui peut signifier à la fois graphème ou phonème, est étudiée dans sa prolation et surtout dans son design graphique, que Tory « moralise » à plaisir. Le dessin correct et proportionné des « lettres attiques » (c'est-à-dire les majuscules latines) sert non seulement de modèle au projet d'une grammaire raisonnée du français calquée sur celle du latin, mais encore de règle de vie pour les amateurs de bonnes lettres (Demonet 1990).
6On s'attendrait donc à trouver une description de la valeur des signes de ponctuation en français, alors qu'il y a peu de chose : à la fin du Livre III, avant que Tory ne présente successivement les différents alphabets, deux courtes pages disent comment il faut dessiner les points « quarres, crochus et triangulaires » dont il ne dit pas la fonction, si ce n'est à travers une citation de Lascaris significativement tirée de sa grammaire grecque (1476) : « Punctum, est sententiae perfectae signum. Cest a dire. Le point est le signe dune sentence perfecte » (f° 65v°). Même s'il énumère ensuite le classement beaucoup plus complet d'Antonius Orobius (« Point suspensif, Point double, Demypoint, Point crochu, Point incisant, Point respirant, Point concluant, Point interrogant, Point respondant, Point admiratif, & Point interposant », 66 r°), il est remarquable qu'aucun ne corresponde vraiment à l'usage pratiqué dans son propre texte imprimé7. Tory, qui avait laissé le soin de l'impression à Gilles de Gourmont (il ne sera imprimeur royal que l'année suivante), a mal révisé son ouvrage et laissé de nombreuses coquilles, tout en innovant avec des guillemets en marge gauche. Ses autres inventions orthographiques se manifesteront dans l'usage des accents et de l'apostrophe (Briefve doctrine, 1533). Comme par jeu, Tory termine ce livre en mettant un point final avec ses remarques sur la ponctuation. Les signes qu'il énumère ne sont pas imprimés, mais gravés comme des dessins8 :
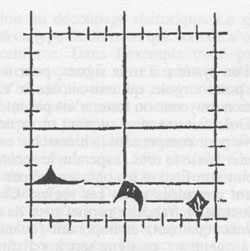
7Les points de convergence manifestes entre la référence à Lascaris et la pratique éditoriale humaniste consistent dans le système à trois signes, dans la fonction minimale de segmentation pour la virgule ou pour la barre oblique, et dans la fonction conclusive du point. La virgule sous la forme que nous connaissons était déjà utilisée au IVe siècle chez Marius Victorinus (Catach 1968 : 297) mais sa forme en barre oblique (la virgula suspensiva) a été utilisée jusque tard dans le XVIe siècle, principalement dans les textes encore imprimés en bâtarde ou en gothique. Le texte de Tory étant en caractères romains, il est logique qu'il ait favorisé la virgule courbe qui correspondait au même système de fonte et à son goût pour les capitales romaines. Il utilise cependant quelques barres obliques sans qu'on puisse leur attribuer une signification spéciale.
8Les discussions et les divergences entre tous les systèmes proposés ou en cours dans les années 1530-1540 tiennent dans la définition de la ponctuation moyenne qui en français à cette époque se partageait entre les deux points, la virgule et un point non final (généralement suivi d'une minuscule). Mais elle n'est pas spécifique au français et l'on connaît des hésitations semblables pour la ponctuation du latin et des autres langues européennes. La possibilité de transférer la ponctuation d'une langue dans une autre suggère implicitement que ces signes son t « universels » et correspondent non pas à la transcription de signes verbaux particuliers, mais à la notation du découpage de la phrase. Elles présupposent l'existence d'une grammaire générale.
9En 1540, Etienne Dolet publie son important Traité de la punctuation dans lequel il assure explicitement que celle-ci est commune à toutes les langues, ce qui l'autorise à négliger ses savants adversaires choqués par la simplification qu'il propose. Son point de vue est à la fois érudit et pratique sans ignorer les complexes traditions grecque et latine, ellesmêmes divergentes, il en prend ce qui convient à l'usage courant des imprimeurs qui connaissaient déjà très bien :
10- la virgule ou point à queue, représentée autrefois par la barre oblique
11- les deux points ou comma
12- le point rond ou colon
13- l'interrogant
14- l'admiratif
15- la parenthèse.
16C'est donc aussi un système à trois signes, pour ne tenir compte que des principaux. Le point-virgule, qui existait dès le VIIe siècle avec des valeurs de ponctuation moyenne ou forte, n'est pas intégré9. A la suite de cette présentation, Dolet fait une mise au point sur la notion de phrase ou « période », décisive pour comprendre la hiérarchie entre le deux points et le point : le premier laisse le sens suspendu, le second clôt la sentence. Il n'y a plus de point non final et les phrases mêmes qui constituent ce traité sont clairement ponctuées selon ces règles. Ce début de théorie syntaxique de la ponctuation française permet aussi de comprendre le rôle à la fois limité (syntaxiquement) et important (quantitativement) de la virgule ou « point à queue » : ce signe sert à « distinguer les dictions, & locutions l'une de l'autre » : substantifs, adjectifs, syntagmes nominaux et syntagmes verbaux. Il n'est pas destiné à séparer de longues propositions, çe rôle étant dévolu pour Dolet aux deux points. Il propose ainsi trois « périodes », à titre d'exemple10 :
[!] L'empereur congnoissant, que paix valait mieulx, que guerre, a faict appoinctement avec le Roy : & pour plus confirmer ceste amytié, allant en Flandre il a passé (chose non esperée) par le Royaulme de France : ou il a esté repceu en grand honneur, & extreme joye du peuple. [2] Car qui ne se resjouyroit d'ung tel accord ? qui ne louerait dieu de veoir guerre assopie, & paix regner entre les Chrestiens ? [3] ó que bien heureux soient, qui ont traicté cest accord ! que mauldicts soient, qui tascheront de le rompre !
17À examiner la segmentation de la première phrase, peut-on déduire que Dolet est plus orateur que grammairien ? Ce que nous savons de l'auteur, cicéronien convaincu, ferait pencher pour la première solution. Mais la lecture de son traité, sa volonté de simplicité et son attention à des critères purement grammaticaux comme la rection ou la délimitation de la « diction », autorisent à penser qu'il a en tête les schémas de la grammaire générale telle qu'elle avait existé en latin du temps des scolastiques11. Ce préalable n'exclut pas l'influence des modèles des artes dictaminis et des textes humanistes qui séparaient la période en cola et en commata selon un découpage rhétorique. Le grammairien Donat avait déjà préconisé ce type de division qui, loin de s'opposer à l'analyse grammaticale, la renforce. Dans l'exemple traité par Dolet, ce qu'il appelle « période » correspond à notre « phrase12 » et la première, qui relate un événement historique avec les motivations du protagoniste, n'a pas de caractère particulièrement oratoire contrairement aux deux suivantes marquées par le pathos. La base en est la « diction », calque du mot dictio, terme fondamental de la grammaire philosophique du latin publiée exactement la même année (1540) par Jules César Scaliger. Cette grammaire « causale », issue de la grammaire spéculative des Modistes tout en étant remodelée d'après Donat et Priscien, fonde l'analyse de la proposition (clause ou colon) sur les constituants correspondant aux commata ou unités plus petites isolant les syntagmes. La période au sens rhétorique permet de comprendre l'agencement des propositions entre elles, qu'elles soient subordonnées ou indépendantes. Dans les exemples donnés et plus généralement à cette époque, il est difficile de distinguer la « sentence » (grammaticale) de la « période ».
18Formé par la même tradition grammaticale, Louis Meigret (Tretté de la grammere françoeze, 1550), donne une présentation des différents signes très proche de celle de Dolet, même s'il parle de « soupirs » et de « pozes ». Son révolutionnaire Traité du commun usage de l'écriture française (1542) avait été republié conjointement avec l'opuscule de Dolet, ce qui souligne la parenté entre les deux auteurs. Toutefois, si les deux points distinguent pour Meigret des membres de phrase, alors que la virgule se limite pour Dolet aux dictions et locutions, Meigret précise que celle-ci peut aussi joindre
la clause à la clause. J'appelle clause, un bâtiment de langage de nom, ou pronom, avec un verbe, soit que le sens soit parfait, ou non : comme, « les gens de bien seroient les plus malheureux de ce monde, s'il n'était point d'autre vie que celle-ci après la mort » (142v°).
19La distinction entre membre et clause n'est pas toujours très claire et les deux termes se superposent13 : nos exemples montrent qu'en effet une proposition circonstancielle en fin de phrase est presque toujours précédée d'une virgule. Toutefois, cette remarque de Meigret permet de rendre compte d'un grand nombre de cas où la virgule usurpe une fonction dévolue aux deux points, à savoir la distinction entre les parties principales de la période, usage si fréquent à la fin du siècle qu'il pouvait devenir le principal critère d'une prose naturelle et familière. Il est certain dans tous les cas que les deux points ont rarement une fonction extensive comme dans l'usage actuel ; s'il arrive que les éditeurs modernes puissent les maintenir pour cette raison, c'est par hasard. Dans son usage étendu de la virgule (séparation des propositions et notamment des circonstancielles), Meigret poursuivait un usage ancien respecté dans les manuscrits médiévaux (Barbance 1992 : 508) et maintenu par Pétrarque (Parkes 1992 : 48).
20Le statut de la virgule oppose en effet la théorie de Dolet à la pratique des imprimeurs, comme l'a montré Mireille Huchon à partir des éditions de Rabelais (1979, 1988). Dolet segmente volontiers de petites unités à l'aide de la virgule, au dépens des deux points préférés par d'autres ateliers. Mais, comme le dit M. Huchon, cet usage est « raisonné » (1988 : 20) et la norme qui s'impose en faveur de l'usage extensif de la virgule est décelable dès les années 1546 à 1553. Si l'usage du point final ne subit aucune modification notable et n'a pas été concurrencé par le point haut d'origine grecque, la possibilité de le faire suivre d'une minuscule se réduit, faisant ainsi disparaître une nuance importante dans la segmentation de la phrase.
21La ponctuation moyenne s'indique par d'autres associations inacceptables pour le lecteur moderne, comme virgule + majuscule ou deux points + majuscule. Pourtant, ces variations sont attestées, systématiques chez Nicolas de Clamanges (Ouy 1987), et se poursuivent encore au siècle suivant. La suspension apportée à la « sentence parfaite », alors que l'énonciateur a encore quelque chose à dire, est notée par Alde Manuce Junior dans ses traités de 1561-1566. Certains éditeurs modernes, qui remplacent dommageablement les deux points par des points et rectifient les majuscules dites aberrantes, font disparaître cette segmentation subtile qui est rarement distribuée au hasard.
22Curieusement Ramus, dans sa Grammaire de 1572, en reste sur le plan théorique à un système déjà archaïque à cette époque et qui rappelle celui de Tory : il revient à la barre oblique pour la virgule et signale les « nouveautés » du temps, soit la virgule qui correspond à son point médian •. En revanche l'ensemble virgule + deux points, parfois utilisé dans les manuscrits mais rarissime dans les imprimés, revient au point-virgule ou aux deux-points de ses contemporains et correspond à son point haut·.
Quelques nouveauls Grammairiens pour les poincts moyen & hault ont introduict ung demicercle & deux poincts ainsi, , : qui nest pas grand differend. (1572 : 14,206)
23Son système s'appuie aussi sur trois signes mais sa « demipose » ou point médian peut partager des unités syntaxiques, comme le faisait la virgule chez Dolet (« mieulx, que guerre »). Cette subdistinctio n'a aucune fonction rhétorique :
Demipose cest une distinction de sentence imparfaicte, & se marque par le poinct moyen, ainsi • (ibid.)
24L'exemple est le suivant :
Car ils estiment estre proufittable tout ce • qui est juste · Aussi jugent ils estre juste tout ce • qui est honneste · que cela mesme soit utile. (ibid.)
25Déjà Tory mettait une virgule entre ce et que, là où Ramus propose son • :
La Maniere descripre en Raouleaux est icy tres abusive en beaucop de facons, & principallement en ce, que daucuns escrivent ung mesme Mot [...]. (Champfleury, Préface, A 3r°)
26Cette marque •, qui lie plus qu'elle ne sépare, a été un peu utilisée en Angleterre14. Elle est différente de ce que Meigret appelle également « semi-poze », c'est-à-dire le deux points.
27Il existe en outre une façon de marquer les syntagmes par l'usage de deux points « faibles », que l'imprimeur du Champfleury utilise dès le début de la pompeuse préface et qu'on retrouve dans le Tiers Livre de 1552. Chez Tory, ces deux points isolent la série de sujets du prédicat et correspondent à la fois à une analyse logique de la phrase et à la distinction en commata, mais non à un découpage d'un membre de la période :
Les Poetes : les Orateurs : & les autres Scavans en Lettres & Sciences : quant ilz ont faict & compile quelque Œuvre de leur studieuse diligence & main, ont de costume en faire present a quelque grant Seigneur de Court ou Desglise en le exaulceant par Lettres & louanges envers la cognoissance des autres hommes. & ce pour luy agreer,[...] (A2 v°)
28Dans le Tiers Livre, ces deux points « faibles » que l'éditeur moderne est tenté de remplacer par une virgule, ne sont ni précédés ni suivis d'espaces, marquant par là leur différence avec les deux points de ponctuation moyenne. On pourrait aussi considérer que Dolet bien qu'il ne s'en explique pas accorde deux valeurs différentes aux deux points : forte, dans « Roy : & pour » où il est précédé est suivi d'espaces ; faible, dans « France:ou il a esté », sans espaces. Le dernier a le rôle de virgule introduisant la clausule de fin de phrase. Mais l'autre exemple d'usage des deux points infirme cette hypothèse car l'auteur paraît égaliser les membres de phrase :
Il est bon de n'offenser personne : car il n 'est nul petit ennemy : & chascun tasche de se venger, quand il est offensé. (ibid.)
29Malgré ces hésitations, le système de Dolet avait l'avantage de la simplicité et de la modernité. M. Huchon a démontré son importance et son influence dans le milieu des écrivains et des imprimeurs. Toutefois, l'attirance pour la ponctuation subtile est très réelle chez les théoriciens, quoiqu'ils ne l'appliquent guère : on notera que la ponctuation idéale à trois signes de Ramus n'est nullement respectée dans l'impression du texte même, ni dans la colonne traditionnelle, ni dans la colonne « réformée », alors que celle-ci applique bien la graphie phonétique, avec accents et cédilles.
NARRATION ET ORATIO SOLUTA30Le style narratif relève, selon les rhétoriciens latins, de l'oratio soluta ou « oraison solue », c'est-à-dire d'un style construit à partir de propositions accumulées, coordonnées ou juxtaposées. Les subordonnées sont surtout des relatives qui s'accrochent aux principales, ou des circonstancielles précédant ou suivant la principale. Ce style s'oppose au style périodique (oratio vincta ou « enchainee »), de structure dite circulaire, dont la construction classique est celle de la protase/apodose, et dont les subordonnées sont hiérarchiquement distribuées dans le « cercle » de la phrase ample15. Le point final, appelé aussi periodos, en marque la conclusion. Les phrases-exemples de Dolet montrent que la période est aussi le nom de la phrase, quelle que soit sa structure rhétorique. Ces deux sens distincts semblent être neutralisés en pratique, ce qui pourrait réduire d'autant la différence entre les deux types d'orationes. Elle reste à notre avis tout à fait pertinente, même si les auteurs passent de l'une à l'autre selon le point de vue qu'ils veulent donner sur la narration. Pour les théoriciens de l'écriture historique, cette opposition démarque le style du chroniqueur, comptable et conteur des faits, de celui du philosophistoricus16, commentateur des événements. Elle est explicitée dans divers ouvrages de rhétorique au chapitre « narration ».
31Voici un exemple d'oratio soluta, pris du premier chapitre des Chroniques Admirables, contemporaines du Gargantua (1535 ?) :
Ledict Merlin fist de grandes merveilles lesquelles sont ung peu fortes a croire a ceulx qui ne les ont veues, ledit Merlin estoil du grant conseil du bon roy Artus, et toutes les demandes qu'il faisoil en la court dudit roy Artus luy estoient accordees et octroyees fust pour luy ou pour aultres il garentist le roy ct plusieurs aultres ses barons et gentilz hommes de grans perilz et dangiers : et fist plusieurs grandes merveilles entre lesquelles il fist une navire de mil cinq cens tonneaulx laquelle alloil vagant sur terre ainsi que vous en voyez aller sur la mer, et fist plusieurs aultres merveilles lesquelles seroyent trop prolixes a racompter, comme vous pourrez veoir plus amplement cy apres. (1988 : 3-4)
32Les membra de la phrase ne sont découpés par une ponctuation moyenne qu’à un seul endroit (le premier « : et fist »)et les commata ne sont pas du tout marqués. La succession des éléments du récit est donnée par seulement deux « virgule + et », la dernière virgule détachant la clausule finale comme c'était l'usage. Même si l'auteur (inconnu) glisse des éléments de commentaires convenus dans ce type de narration sur la difficulté à croire et à énumérer de telles merveilles, ceux-ci sont présentés sur le même plan que les événements et sans hiérarchisation. Les relatifs jouent un rôle important dans la continuité de la narration : l'articulation de l'histoire par les pesants dérivés de lequel est un trait spécifique de la prose narrative française de cette époque, comme l'avait établi Alexandre Lorian (1973). La comparaison avec un passage du Gargantua de Rabelais permettra d'évaluer l'importance accordée à la ponctuation à partir de la réflexion humaniste sur la phrase.
33Les romans de Rabelais présentant les deux styles, narratif et réflexif, ils devraient aussi offrir les deux tendances distinguées par les rhétoriciens. La question est de savoir si la ponctuation y joue un rôle quelconque. Considérons le début du chapitre 4 de Gargantua (« Comment Gargamelle estant grosse de Gargantua mengea grand planté de tripes ») dans sa version de 1542 qui offre trois retouches de ponctuation par rapport à 1534 :
L'occasion et maniere comment Gargamelle enfanta fut telle. Et si ne le croyez, le fondement vous escappe. Le fondement luy escappoit une apresdinee le iij jour de febvrier, par trop avoir mange de gaudebillaux, [1534 .] Gaudebillaux : sont grasses tripes de coiraux. Coiraux : sont beufz engressez a la creche et prez guimaulx. Prez guimaulx : sont qui portent herbe deux fois l'an. D'iceulx gras beufz avoient faict tuer troys cens soixante sept mille ct quatorze, pour estre a mardy gras sallez : affin qu'en la prime vere ilz eussent beuf de saison a tas, pour au commencement des repastz faire commemoration de saleures, et mieulx entrer en vin.
Les tripes furent copieuses, comme entendez : et tant friandes estoient [1534 ,] que chascun en leichoit ses doigtz. Mais la grande diablerie a quatre personnaiges estoit bien en ce que possible n'estoil longuement les reserver. Car elles feussent pourries. Ce que sembloit indecent. Dont fut conclud, [1534 .] qu'ilz les bauffreroient sans rien y perdre. (1999 : 23-24)17
34Lu à notre mode, le récit est extrêmement divisé, mais pas là où nous le ferions. Dans ce discours interpolé d'explications et de réflexions, il est difficile de déterminer les limites de la « période » comme de la « phrase », pour le second paragraphe comme pour le premier18, puisqu'il y a plusieurs points qui ne sont pas conclusifs mais marquent une ponctuation moyenne majeure. Le système appliqué serait non pas à trois niveaux comme chez Dolet, mais à quatre, puisqu'on voit deux types de pauses majeures, celle du point qui ne termine pas la phrase et celle des deux points qui signalent les membra, les commata étant (théoriquement) délimités par les virgules. La comparaison avec Dolet montre aussi que Rabelais ou son imprimeur n'appliquent pas la division en « dictions » ou syntagmes préconisée par le premier, mais qu'ils en restent à l'usage plutôt rhétorique de marquer les membra propositionnels qui sont ici souvent explicatifs ou commentatifs : par trop avoir... pour estre.... affin que... pour au commencement... comme... tant que... car... dont...
35Cette surabondance de tripes et d'explications n'est probablement pas sans intention : ici, Rabelais parodie précisément le style des historiens graves qui donnent pour chaque élément de la narration, si dérisoire soit il, sa cause matérielle et finale. Le récit du fait et son commentaire sont étroitement imbriqués. Les pauses fortes constituées par les points intermédiaires (plus fréquents dans la première édition) sont à interpréter non comme une indication d'intonation descendante mais comme celle d'une pause plus longue, puisque le narrateur ou les personnages se prennent à réfléchir.
36L'effet de dislocation n'exclut pas du tout la maîtrise d'un récit qui n'échappe pas au narrateur. Ces ruptures reproduiraient-elles la vivacité orale du conte? Il y en a peu d'indices. Les discours théoriques comme les textes imprimés ne disent rien de la prosodie. Les critères sémantico-logiques, appliqués très tôt avec des variantes, sont congruents avec la pratique des imprimeurs, que Dolet et Meigret théorisent après coup pour le bien des doctes. On sait que Rabelais fréquentait beaucoup ces milieux, à Paris et à Lyon19. Quant à Meigret, il a influencé Rabelais et également Montaigne, sans doute indirectement par l'intermédiaire de Laurent Joubert (157920). André Tournon a montré à quel point il faut tenir compte des plaintes de Montaigne à l'encontre des imprimeurs qui ont modifié sa ponctuation : si ceux-ci « rompent du tout le sens », c'est qu'ils interviennent dans la hiérarchie des propositions à l'intérieur de la phrase et bousculent la répartition entre point, deux points et virgule. Les corrections manuscrites à l'exemplaire de Bordeaux indiquent de façon très précise comment Montaigne entendait qu'on ponctue : les multiples transformations de point + majuscule en virgule + majuscule étendent considérablement la ligne de la phrase et font éclater la période21. Lorsqu'il dit « je n'enseigne point, je raconte », Montaigne oppose explicitement le docere au dicere et range son style du côté de l'oratio soluta, domaine de la narration simple.
37Tory et Dolet appartiennent à la génération des cicéroniens français, à la fois défenseurs d'un latin classique et de la grammatisation des langues vernaculaires. Les relations entre Rabelais et Dolet ont été fluctuantes : après avoir été son ami. Rabelais s'est brouillé avec lui mais il garde en grande partie son système de ponctuation22. Son retour à des graphies étymologisantes dans les dernières éditions de ses romans semble marquer un éloignement réel des volontés réformistes des cicéroniens, mais cet habillage savant des romans n'affecte pas la ponctuation. Selon M. Huchon, Rabelais aurait été sensible à un projet de « conjonction des quatre langues » (français, latin, grec, hébreu), dont Charles de Sainte Marthe avait eu l'idée23. Au-delà de la ponctuation visible, c'est la conformité de la structure de la pensée avec celle des langues qui est en jeu.
38La comparaison de la ponctuation des premiers romans rabelaisiens avec la traduction en allemand de la « belle Maguelone » en 153524 argumente en faveur de la recherche d'une « raison commune » de la ponctuation25. Celle-ci a été analysée en fonction de la distribution des membres de phrases par Franz Simmler qui disposait d'un manuscrit et de l'imprimé. Le traducteur, Veit Warbeck, était lié à Luther et ses idées sur la langue n'étaient pas sans rapport avec sa conception du neu Hochdeutsch, à élever, comme le français, au rang de langue noble. Les deux points, très fréquents, ont pour rôle principal de marquer la construction fondamentale de la période, et partagent avec le point et la barre oblique le rôle d'introduire le discours direct. Comme en français, le point joue un rôle macrostructurel ; la barre oblique peut aussi être suivie d'une majuscule et und est précédé, comme Dolet le voulait pour et, de cette même barre. La phrase, généralement composée de 2 à 4 membres, est destinée à mettre en valeur la chronologie et la linéarité du récit. Bien que l'ordre des mots ne soit pas le même dans les deux langues, les principes qui régissent la ponctuation rythmique et syntaxique sont fort voisins de ceux des auteurs français. On peut conjecturer que la culture latine commune aux érudits européens en est aussi responsable : le moule du style de César ou de Cicéron, ponctué à la moderne, construit une koiné de la ponctuation.